Qu'est-ce que le droit d'auteur ?
L'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que toutes les œuvres de l'esprit sont protégées, quel que soit leur genre, leur forme d'expression, leur mérite ou leur destination. Cependant, pour bénéficier de cette protection par le droit d'auteur, les œuvres doivent être à la fois originales et formalisées. L'originalité implique que l'œuvre porte la marque de la personnalité de l'auteur ou reflète son apport intellectuel, comme c'est le cas pour les logiciels. De plus, l'œuvre doit être matérialisée, ce qui signifie que les idées et les concepts non formalisés ne peuvent pas être protégés et doivent rester accessibles à tous.
Ainsi, le droit d'auteur octroie une protection aux oeuvres répondant à des critères du seul fait de leur création.
Le droit d'auteur se divise en droits moraux et droits patrimoniaux :
Les droits moraux, attachés à la personne de l'auteur, incluent le droit au respect de l'œuvre et de l'identité de l'auteur, tels que le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, ainsi que le droit de retrait et de repentir. Ces droits sont perpétuels, inaliénables et transmissibles aux héritiers.
En revanche, les droits patrimoniaux concernent l'exploitation économique de l'œuvre et sont cessibles à des tiers. Ils comprennent le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d'adaptation, le droit de traduction, ainsi que le droit de suite pour les auteurs d'arts graphiques et plastiques. Ces droits sont limités à une durée de 70 ans après la mort de l'auteur et peuvent faire l'objet de cessions spécifiques détaillées dans un contrat.
Le droit d'auteur a été harmonisé à l'échelle mondiale grâce à la Convention de Berne, ratifiée par 181 pays jusqu'au 9 juin 2022. Parmi les signataires figurent tous les pays européens, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, l'Australie, et d'autres. Selon cette convention, si l'auteur est ressortissant d'un pays signataire ou si son œuvre a été publiée pour la première fois dans l'un de ces pays, il bénéficie automatiquement de la protection prévue par la Convention de Berne dans chaque État membre, équivalente à celle accordée aux œuvres des nationaux de cet État.
Aux Etats-Unis, il est possible de bénéficier d’une protection supplémentaire en déposant les œuvres protégées par le droit d’auteur auprès du Copyright Office. Ce dépôt ne constitue pas une condition de protection d’une œuvre aux Etats-Unis mais la loi américaine confère certains avantages à ceux qui y ont recours.
Les avantages du droit d'auteur
Le droit d'auteur protège les œuvres originales dès leur création, offrant ainsi une sécurité juridique contre la copie et l'exploitation non autorisée.
Le titulaire peut exploiter commercialement ses créations, les vendre, ou les concéder sous licence à d'autres entreprises au titre des droits patrimoniaux, sous réserve du respect des droits moraux.
En assurant une protection contre la reproduction non autorisée, le droit d'auteur encourage les créateurs à investir du temps et des ressources dans de nouvelles œuvres, stimulant ainsi l'innovation culturelle, artistique et technologique.
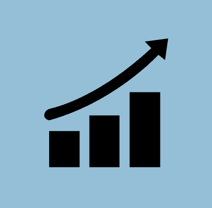
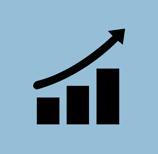




Absence de formalité obligatoire
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété [intellectuel] ». Il en ressort qu’aucune condition de formalité n’est nécessaire pour qu’une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
Il n’est donc pas exigé de déposer ses créations auprès d’un organisme pour bénéficier de droits sur celui-ci comme c’est le cas en droit des brevets et en droit des marques. Les dépôts proposés par certains organismes, tels que l’Agence pour la Protection des Programmes (pour les logiciels), ou encore par l'INPI avec l'e-soleau, sont donc effectués à titre probatoire (à titre de preuve).
Effectuer un dépôt probatoire offre plusieurs avantages, notamment en établissant une preuve d'antériorité et de propriété de l'œuvre, ce qui est crucial en cas de litige sur la paternité ou la date de création. Il constitue une précaution juridique solide contre le plagiat ou la copie, et apporte une reconnaissance officielle de l'œuvre à une date précise. De plus, il assure à l'auteur une certaine sécurité, facilite les négociations de contrats et renforce la position de l'auteur lors de cessions de droits. Bien que soumis à l'appréciation du juge, il est fortement recommandé d'effectuer un dépôt à titre probatoire pour ses créations, mais également pour ses inventions, notamment avant un dépôt d'une demande de brevet.
Ainsi, on ne protège pas réellement un logiciel puisque cela est automatique du fait du droit d'auteur. Le titulaire doit seulement prendre conscience qu'une création, qu'une oeuvre est soumis au droit d'auteur, et est également valorisable.
La titularité des droits d'auteur ?
En principe, le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre est l'auteur lui-même, défini comme la personne physique ayant créé l'œuvre ou sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée (article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ainsi, même en présence d'un contrat de travail ou d'un lien de subordination, aucun transfert implicite des droits au profit de l'employeur n'est automatique. En conséquence, lorsque l'œuvre est créée par un salarié, ce dernier conserve la titularité des droits sur la création, et non l'employeur, même si l'emploi impliquait la création d'œuvres.
Cependant, l'employeur peut devenir titulaire des droits dans trois cas spécifiques : tout d'abord, pour les logiciels créés par un ou plusieurs employés dans le cadre de leurs fonctions ou selon les instructions de l'employeur, où les droits patrimoniaux sont automatiquement dévolus à l'employeur (article L113-9 du CPI). Ensuite, pour les œuvres collectives créées sur initiative d'une personne physique ou morale, publiées sous sa direction et son nom, où la contribution des auteurs se fond dans un ensemble indissociable, les droits appartiennent à l'employeur (article L113-2 et L113-5 du CPI).
Enfin, lorsque l'auteur cède ses droits patrimoniaux à l'employeur, cette cession doit respecter des formalités spécifiques et ne peut inclure des œuvres futures non encore créées par le salarié. Il est donc essentiel que chaque œuvre cédée soit clairement identifiée dans le contrat de cession. En cas d'activité créatrice régulière, des contrats de cession périodiques peuvent être conclus (mensuellement, trimestriellement, etc.), mais une cession générale et imprécise des droits d'auteur n'est pas valable. Il en est de même pour les stagiaires.
Petite exception pour les agents de l'Etat ! Dans cette situation, en résumé, toutes oeuvres crées dans le cadre de votre fonction est automatiquement transféré à l'organisme public.
Pour en savoir-plus sur les droits d'auteur, n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien de l'Agence pour la Protection des programmes.
